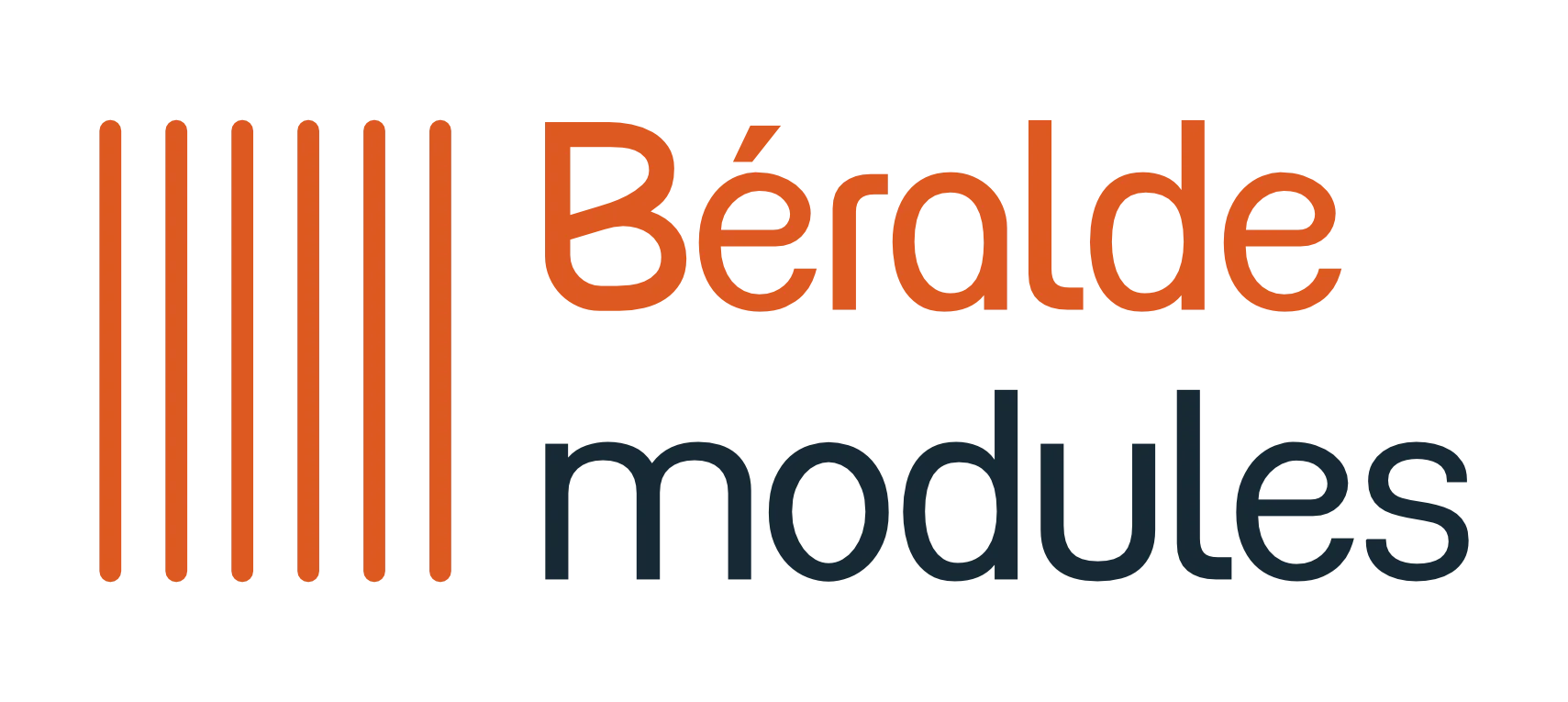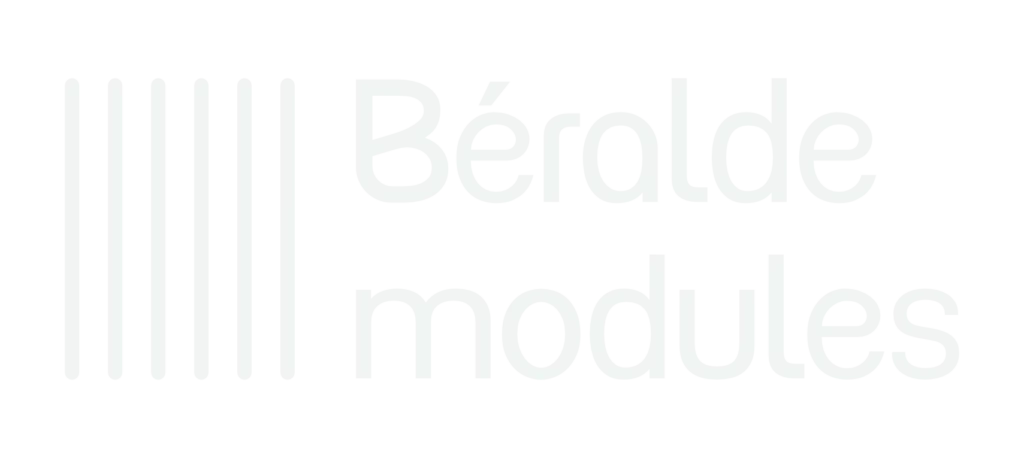Cette garantie, mise en place en 1978 par la loi Spinetta, permet la réparation des dommages affectant la solidité de l’ouvrage ou le rendant inutilisable. Cette garantie s’associe également à une obligation d’assurance aussi bien pour le maître d’ouvrage que pour le constructeur lui-même.
La responsabilité des constructeurs aux yeux de la loi n’est pas chose nouvelle. On retrouve cette notion de responsabilité dès l’article 1792 et 1792-4-1 du code civil en 1804. Malgré une première modification en 1967, il a fallu attendre le rapport Spinetta de 1975 pour que la garantie décennale trouve pleinement son champ d’application.
Ce rapport Spinetta, du nom de son auteur Adrien Spinetta, mettait en relief trois points essentiels dans le règlement des contentieux en droit de la construction, points qui devaient absolument être rectifiés : des délais de traitement beaucoup trop longs, une augmentation constante des charges des sinistres et enfin l’impact de la sous-assurance du secteur de la construction.
Durant les années 1970, les procédures juridiques étaient extrêmement longues. Si on était chanceux, une indemnisation pouvait éventuellement survenir en moyenne 8 ans après la déclaration des sinistres. Dans certains cas, les procédures pouvaient durer jusqu’à 20 ans. Outre ces délais à rallonge, le rapport faisait état d’une forte baisse de la qualité des constructions induisant une augmentation régulière du montant des sinistres. Enfin, et c’est également sur ce point qu’intervint la loi Spinetta, les constructeurs et maîtres d’ouvrage n’étaient jusqu’à lors que rarement assurés, ce qui entraînait des indemnisations basées sur les fonds propres disponibles.
Qu’est-ce qu’un ouvrage ?
Trois critères mis en évidence par la jurisprudence
La garantie décennale prend pour point de départ la réception de l’ouvrage. Or, ce terme, qui est pourtant la clé de voûte de la garantie décennale, n’a pas de définition juridique officielle. D’un point de vue classique, l’ouvrage se définit comme étant le fruit du travail de l’artisan. Une définition qui fait sens mais dont les contours exacts restent difficiles à cerner d’un point de vue juridique. C’est ainsi que la jurisprudence a fait émerger plusieurs critères permettant de cerner la notion d’ouvrage, dont la définition juridique exacte continue de faire débat.
La garantie décennale, dans son application, doit concerner la réalisation de travaux qui constituent eux-mêmes la construction d’un ouvrage. La jurisprudence met en avant ce qu’on appelle le critère d’immobilisation : l’ouvrage se définit par un rattachement au sol ou à une partie d’ouvrage préexistante.
Dans ce critère d’immobilisation, la jurisprudence a par exemple déterminé comme répondant à la notion d’ouvrage l’implantation de bungalows. Ainsi, dans une décision du 28 Janvier 2003, la justice a conclu que ces modes d’habitation ne constituaient pas uniquement un assemblage d’éléments en bois posé à même le sol mais des constructions fixées sur des plots et longrines en béton par des plaques de fer. De telle sorte qu’ils ne pouvaient être ni déplacés, ni transportés.
En 2012, la jurisprudence a également statué qu’une terrasse faisant corps avec sa maison, reposant sur des fondations de conception artisanale devait également être considérée comme un ouvrage.
Dans le même temps et paradoxalement peut-être, sur la base de ces deux éléments, la Cour de cassation a estimé qu’une maison mobile, livrée par camion et posée au sol sans travaux, ni fondation, ne constitue pas un ouvrage immobilier (Cass. Civ III, 28 avril 1993, n°91-14215 ; Bull. civ. 1993, III, n°56) et ne relève donc pas de l’assurance décennale.
La notion d’ouvrage reste donc un point très débattu. Si la jurisprudence permet d’éclairer quelques points, elle ne résout pas totalement la question : à partir de quand une construction est-elle considérée comme un ouvrage aux yeux de la Loi ?
Un autre critère d’éligibilité d’une construction à la notion ouvrage réside dans ce qu’on qualifie d’importance des travaux réalisés. Sur ce point, la jurisprudence a, par exemple, considéré comme un ouvrage des éléments tels que des travaux de réhabilitation dans un immeuble afin de le rendre habitable aux yeux de la Loi, des travaux de rénovation affectant la structure de l’immeuble, mais aussi des travaux de restauration de pierres de façade pour maintenir une étanchéité à un immeuble, ou encore des travaux pour conforter l’existant ainsi que des travaux de démontage et de remise en état de certaines parties de garde-corps qui ne constituent pas un simple rafraichissement.
A l’inverse, une installation de chauffage, la mise en place d’une isolation thermique de façade ou des travaux de rénovation en dessous d’un coût de 4 483,08 francs (Cass., Civ. III, 14 avril 1999, n° 97-17.552) n’ont pas été considérés comme des ouvrages par la Cour de cassation.
Enfin dernier critère pris en compte par la jurisprudence : la nature spécifique des travaux et l’adjonction de matériaux. Sur ce critère, il a été jugé que relevait de l’ouvrage l’aménagement de combles avec l’apport d’éléments nouveaux à la toiture, la construction d’un mur de soutènement faisant appel à des techniques précises de travaux en bâtiment, des travaux de rénovation relevant de la technique de bâtiment pour un coût supérieur à 650 000€ TTC, ou encore la pose d’un liner pour l’étanchéité d’un bassin.
Ainsi, la frontière juridique permettant de définir des travaux comme relevant des ouvrages ou pas est très mince et soumise à interprétation.